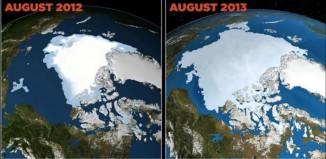8N, des casseroles contre les politiques sociales ?
Buenos Aires, Argentine 8 novembre 2012
Un vent de protestation souffle contre Cristina Kirchner, l’actuelle présidente de l’Argentine,et pas seulement depuis la base et les secteurs populaires. Les classes aisées de la population se sont rassemblées jeudi 8 novembre, casseroles à la main pour protester contre certaines mesures du gouvernement. Oui mais lesquelles ? Pablo Pryluka, historien de l’Université de Buenos Aires nous propose un éclairage historique intéressant dans un article publié à l’origine par Marcha.org.ar, accompagné des photos du collectif En La Vuelta-Acción fotográfica.

Et le fameux 8N tant attendu a eu lieu. Parmi les slogans et réclamations, on remarque la condamnation des aides sociales.Les casseroles indignées ont défilé. Les slogans plus ou moins vides sont restés. Les images et les histoires aussi. Et au cœur de tout cela, une demande n’est pas passée inaperçue. On aura pu entendre ce jeudi 8N de vives critiques envers les aides sociales, toujours accompagnées d’une d’indignation morale. Prenez l’exemple d’une pancarte qui résume bien l’une des motivations de ceux qui ont participé à la manifestation: «Mi $ = mon travail. Je ne veux pas entretenir des faignants ». Le fait, insignifiant en lui-même, apparaît comme un manifeste émanant pourtant de nombreuses voix. Il n’est alors pas inutile de réfléchir à la question.
A la veille de l’un des événements qui allait secouer le monde en 1789, la Révolution française, l’abbé Sieyès publiait son «Qu’est-ce que le Tiers Etat», qui arriva à l’immortalité comme l’un des témoignages les plus symptomatiques de la France révolutionnaire. C’est là qu’il partagea, sa fameuse phrase: «Qu’est-ce que le troisième? Tout, mais un tout enfermé et les opprimé. Que serait-il sans l’ordre des privilégiés? Tout, mais un tout libre et florissant. » Le peuple de France, le Tiers Etat, était opposé à ces deux autres qui avaient dominé la scène politique jusqu’à présent: le clergé et l’aristocratie. Les deux, sans payer d’impôts et en vivant dans l’abondance des revenus qu’il tirait du reste de la population française, étaient les parasites d’une société qui commençait à changer. L’histoire qui suit, celle des rois décapités et les républiques, est connue.
Quelques décennies plus tard, la scène se répète à la fois de manière semblable et pourtant différente. Après la crise révolutionnaire et la Restauration de la monarchie, commence à se produire dans les années 1830 un changement notable, qui finira par éclore lors de la Révolution de 1848. Cette fois, ce n’est pas un abbé qui a prononça les paroles attendues, mais Efrahem, un cordonnier: «Les travailleurs de différents métiers se plaignent de leurs salaires insuffisants pour répondre à leurs besoins. Les oisifs mangent bien, parlent beaucoup, écrivent longuement sans ne rien dire. » Cet ouvrier met sur la table une des antinomies qui régit en partie l’arène politique depuis au moins un siècle et demi. Les travailleurs, successeurs du Tiers Etat, étaient opprimés par une nouvelle race de privilégiés, la bourgeoisie émergente. Si le conflit a été présenté comme un même duel – ceux qui produisent contre ce qui profitent -l’objet de la diatribe avait changé. Les vrais travailleurs devraient mettre fin aux privilèges de ceux qui les exploitent quotidiennement pour vivre de la richesse qu’ils produisent.
L’Argentine contemporaine est donc la scène d’un curieux théâtre. Des entrepreneurs, plus ou moins jeunes, qui ont complètement changé les deux pôles de cette relation: les privilégiés sont désormais ceux qui profitent de l’abondance de plans sociaux, parasitant l’effort des gestionnaires et des patrons. Ou pire, des travailleurs qui voient en leurs pairs exclus du système ceux qui les empêchent d’être les consommateurs qu’ils veulent être.
Bien sûr, nous ne parlons pas ici du clientélisme qui touche certains programmes sociaux, souvent manipulés une logique punteril( mafieux pourrait-on dire). Nous nous référons ici à la critique du principe d’aide sociale dans son ensemble. Ce qui est à moi est à moi, je le protège des politiques sociales et le met sous mon matelas, bien caché. Il n’y a pas d’appartenance à un corps publique, qui unifie de manière égale ceux qui en font partie. Il reste la figure du corps individuel, patron de son propre bonheur, qui ne voit que dans ses semblables le parasite à éliminer. Il semble parfois que l’histoire se répète plus que deux fois, bien que nous nous réservions le label de la troisième.
- Nous t’attendons dans la rue.